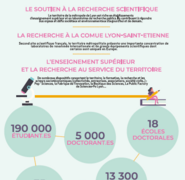Parceque le territoire soutient la recherche, la Métropole et la Ville de Lyon, en partenariat avec la ComUE Université de Lyon, décernent chaque année le Prix de la Jeune Recherche. Il distingue des lauréats dont le talent, après la thèse, a été confirmé par des premiers travaux de recherche remarquables mais également un investissement dans la diffusion de la culture scientifique et la transmission de leurs travaux auprès de la société civile.
Pour cette édition 2025, quatre projets ont été lauréats parmi plus d'une trentaine de candidatures. Les jeunes chercheurs ont reçu leur prix de 4500 euros lors d'une cérémonie organisée mardi 4 novembre à la I-Factory.
3 grandes thématiques sont représentées :
- Sciences Exactes
- Santé et Sciences de la Vie
- Sciences Humaines et Sociales
Un prix « coup de cœur » du jury est également décerné à un candidat dont les recherches sont particulièrement innovantes et prometteuses tout en répondant aux enjeux et défis sociétaux.
Les lauréats
Prix Sciences Humaines et Sociales
- Remis à Jean-Benoît Krumenacker, 37 ans pour ses travaux sur la révolution médiatique liée à l’invention de l’imprimerie et les transformations contemporaines liées au numérique et aux nouvelles technologies

Après un parcours universitaire en histoire à l’université Lyon 2 et Lyon 3, il soutien une thèse sur la transformation du livre à Lyon entre la fin du Moyen Âge et le début de l’époque moderne. Désormais enseignant-chercheur à l’université Lumière Lyon 2, ses travaux portent sur la révolution médiatique liée à l’invention de l’imprimerie et offrent un éclairage sur les transformations contemporaines liées au numérique et aux nouvelles technologies.
Ces recherches, qui remettent au premier plan l’histoire lyonnaise de l’imprimerie, permettent de comprendre comment la société a évolué et s’est approprié de nouveaux outils autour des années 1 500. Jean-Benoit Krumenacker fait ainsi rayonner l’histoire riche et complexe de Lyon, tout en soulignant son rôle clé dans l’histoire européenne, notamment à travers les réseaux intellectuels et commerciaux dont la ville faisait partie.
En parallèle de ses publications académiques, il a contribué à la vulgarisation scientifique, notamment pour le musée Gadagne dans le cadre du parcours permanent « Qu’est-ce que tu fabriques ? Lyon industrielle et ouvrière », inauguré en 2022.
Prix Sciences Exactes
- Remis à Lucie Merlier, 39 ans pour ses travaux sur l’adaptation des villes aux surchauffes urbaines

Attirée par l’excellence de la formation à l’INSA de Lyon, elle a quitté la région parisienne en 2003 pour y compléter un doctorat en génie civil avant d’exercer en tant qu’enseignante-chercheure à l’IUT Lyon 1. Ses travaux portent sur l’adaptation des villes aux surchauffes urbaines, un enjeu sociétal majeur, notamment sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Avec son équipe et en collaboration avec divers acteurs académiques et territoriaux, Lucie Merlier vise à produire une connaissance scientifique de haut niveau dans le but d’accompagner l’adaptation des territoires urbains face aux défis environnementaux et sociaux contemporains et futurs, en prenant le territoire de la Métropole de Lyon comme terrain pilote. Cela se concrétise notamment à travers le projet VF++, qui vise à intégrer des solutions vertes et durables pour améliorer la santé et le bien-être des habitants. Ce projet ambitieux a récemment été lauréat de l’appel à projets 2024 du PEPR Villes durables et bâtiments innovants.
Engagée à l’échelle locale, nationale et internationale, Lucie Merlier diffuse ses travaux à travers de nombreuses publications et collabore avec plusieurs réseaux scientifiques. Elle encadre également une équipe de jeunes chercheurs reconnus pour leur excellence et participe activement à la médiation scientifique auprès du grand public, notamment via des cours, articles et actions de science participative.
Prix Santé et Sciences de la Vie
- Remis à Armando Andres Roca Suarez, 37 ans pour ses travaux sur la façon dont certains traitements stimulent le système immunitaire pour combattre le VHB (hépatite B).

Dès ses premières années d’études de médecine en Bolivie, il a été intrigué par la variabilité des réponses aux traitements, ce qui l’a poussé à s’engager dans la recherche en médecine de précision. Après un doctorat à Strasbourg axé sur le virus de l’hépatite C et le cancer du foie, Armando Andres Roca Suarez a rejoint l’équipe lyonnaise spécialisée dans le virus de l’hépatite B (VHB) en tant que chargé de recherche à l’Institut d’Hépatologie de Lyon.
Ses recherches portent sur la façon dont certains traitements stimulent le système immunitaire pour combattre le VHB. Il travaille notamment sur un modèle innovant utilisant de fines tranches de foie, conservées en laboratoire, qui permettent d’étudier de près la réaction des cellules dans un environnement très proche de celui du foie réel. En parallèle, il étudie les profils immunitaires des patients pour découvrir des signes biologiques (biomarqueurs) qui pourraient aider à mieux adapter les traitements à chaque personne.
Le VHB constitue un défis médical majeur. Ces nouveaux modèles pour l’étude du foie humain visent à améliorer la prise en charge et la guérison des patients ainsi qu’à réduire le recours à l’expérimentation animale
Prix Coup de coeur du jury - Enjeux et Défis Sociétaux
- Remis à Claire Padovani,31 ans pour ses travaux sur l’organisation sociale du travail dans les sociétés mésopotamiennes.

Après avoir soutenu son doctorat en Archéologie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2023, Claire Padovani a rejoint en 2024 le laboratoire Archéorient à Lyon en postdoctorat, intégré au projet ANR FACT.WORK. Ce cadre interdisciplinaire lui a permis de développer ses missions de terrain en Iraq, notamment en dirigeant son propre projet au Kurdistan iraquien.
Ses travaux portent sur l’organisation sociale du travail dans les sociétés mésopotamiennes et visent à comprendre les mécanismes de complexification socio-économique à l’origine des premiers systèmes urbains et étatiques du Proche-Orient entre le 7e et le 3e millénaire avant notre ère. Ses recherches remettent en question le modèle classique d’évolution linéaire et offrent une nouvelle lecture des transformations sociales, culturelles et techniques, notamment à travers l’étude des ateliers de potiers.
L’objectif est de mieux comprendre les relations historiques entre sociétés et environnement, afin d’alimenter les débats écologiques et économiques contemporains. Son travail éclaire ainsi les enjeux d’écologie industrielle, de résilience sociale et de transition énergétique, en offrant une lecture approfondie des interactions entre techniques, sociétés et territoires
Les chiffres clés de la recherche sur le territoire
- 190 000 étudiant.es
- 13 300 chercheurs et chercheuses
- 5 000 doctorant.es
- 983 thèses soutenues
- 178 laboratoires de recherches
- 35 établissements membres et associés
- 18 écoles doctorales